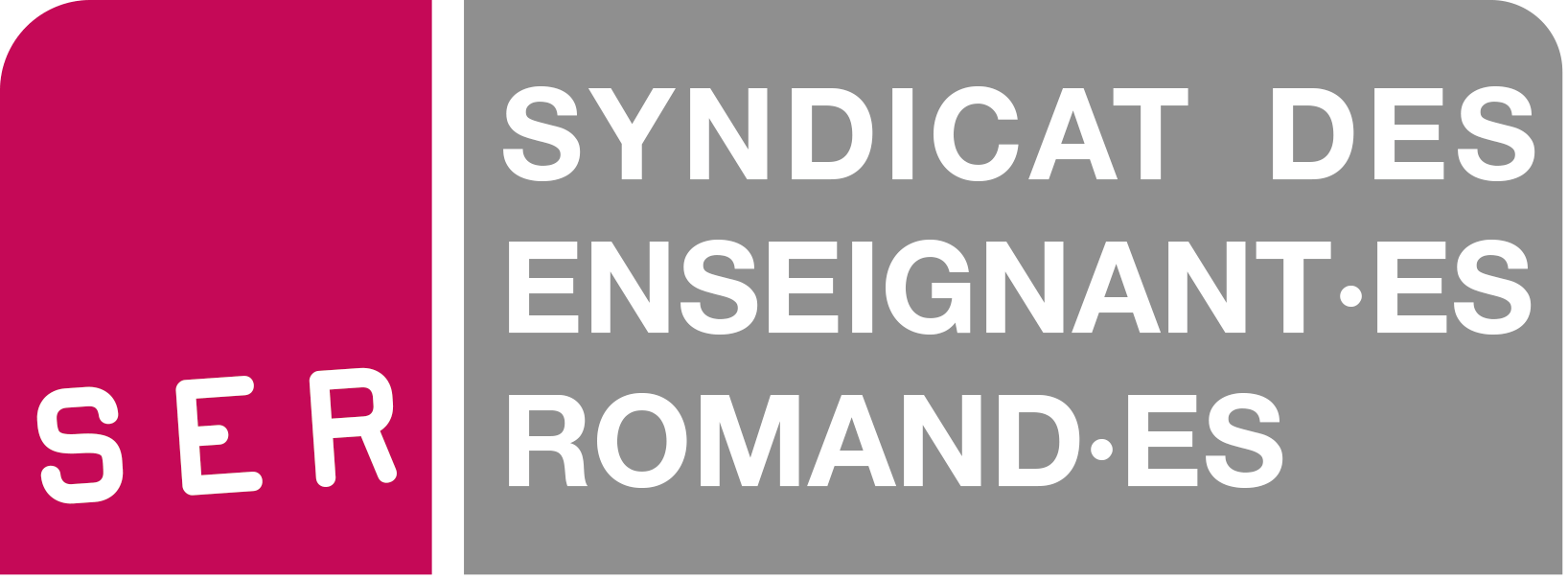Eh oui ! C’est déjà la rentrée … Comme le temps passe vite ! Dans nos vies quotidiennes, comme dans nos salles de classe, une impression domine : tout va de plus en plus vite. Cette sensation n’est pas qu’un ressenti personnel. Elle est au cœur de la réflexion du sociologue et philosophe Hartmut Rosa, qui propose une lecture critique de la modernité à travers le prisme de l’accélération sociale.
Trois formes d’accélération auto-propulsées
Dans son livre Aliénation et accélération (2014) , Rosa distingue trois types d’accélération :
1. L’accélération technique : Elle concerne les moyens de transport, de communication, ou encore le traitement de l’information et impacte les changements sociaux.
2. L’accélération des changements sociaux : Là où autrefois un métier ou un mode de vie se transmettait de génération en génération ; aujourd’hui, il n’est pas rare de changer plusieurs fois de métier ou de recomposer sa famille au cours d’une vie. Les structures familiales, les parcours professionnels, les normes culturelles évoluent de plus en plus vite, accélérant le rythme de vie.
3. L’accélération du rythme de vie : C’est la perception subjective mais bien réelle de manquer de temps. Nous cherchons à faire toujours plus en moins de temps, à vivre davantage d’expériences, à optimiser chaque minute. Le temps devient une ressource rare, presque une marchandise. Ci-fait que nous poursuivons une quête de gain de temps qui peut se réaliser au travers des innovations technologiques que nous inventons … la boucle est ainsi formée.
Rosa montre que la compétition économique et la quête de la réussite sont les véritables moteurs de cette accélération. Dans une société où la performance est mesurée par la quantité de travail accompli dans un temps donné, ralentir devient un luxe, voire une faute.
Il existe aussi une dimension existentielle à l’accélération qui semble être une réponse moderne à l’angoisse de la finitude. Vivre vite, c’est tenter de vivre plus, de tout expérimenter avant qu’il ne soit trop tard, avant la mort.
Enseigner dans un monde qui s’accélère
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous chères et chers collègues, mais pour moi cette analyse résonne fortement. L’école elle-même est prise dans cette dynamique : programmes à boucler, injonctions à innover, pression des évaluations, multiplication des tâches administratives … Et les élèves, eux aussi, vivent cette accélération : surcharge d’activités, sollicitations numériques constantes, zapping de tâches et difficulté à se concentrer sur une longue période, font partie des grands constats que nous faisons depuis plusieurs années.
Rosa remarque que « le temps de l’expérience et le temps du souvenir ont des qualités inverses : si vous faites quelque chose qui vous plait vraiment, et que vous en ressentez beaucoup d’impressions fraiches, intenses et stimulantes, le temps s’écoule normalement très vite. Mais à la fin de la journée, vous vous retournez, vous avez inévitablement le sentiment que la journée a été extrêmement longue » (p. 128). Le rapport perçu du temps suit un motif bref/long (dans le rapport entre l’action elle-même et le souvenir de cette action).
Avec l’accélération des rythmes de vie, les formes d’expériences du temps changent, en suivant un motif bref/bref. Par exemple, si l’on surfe sur internet, le temps passe très vite n’est-ce pas ? On scrolle … À la fin de la journée toutefois, le souvenir du temps passé est également perçu comme bref.
Il existe une « tendance à l’effacement (ou refus du stockage) des traces mémorielles » (p. 130). « Toutes ces activités ont comme résultat des épisodes isolés d’action et d’expérience qui ne se connectent pas aux autres d’une façon intégrée ou significative. Finalement, nous nous souvenons à peine d’avoir été là » (p. 131).
Quelques pistes de et en travail
Sans prétention aucune, voici quelques possibles à mettre en œuvre.
a) Dans les premiers degrés de la scolarité, proposer des temps longs et réguliers de « jeux de faire-semblant » (Le groupe GIRAF préconise au minimum une heure en continu tous les jours en 1-2 P ; des temps plus longs, jusqu’à 2 périodes en continu 2-3 fois par semaine en 3 P et au moins une heure par semaine en 4 P)
b) Proposer des projets longs où les élèves peuvent approfondir un sujet, le reprendre, le retravailler – dans toutes les disciplines.
c) Prendre le temps d’écrire, de réécrire, de relire et discuter les idées.
d) Créer des rituels et assemblées pour discuter des sujets qui préoccupent les élèves.
e) Prendre le temps de l’observation et de la contemplation. Sortir, admirer.
f) Instaurer des temps de philosophie et discuter « qu’est-ce qu’une scolarité/une vie réussie ? » ; « Qu’est-ce que la richesse » ?
g) Travailler à l’esthétisme … y compris en mathématiques … Qu’est-ce que le beau ?
Et si la lenteur n’était pas le contraire de la rapidité ? Que serait-elle ? Peut-être un moyen d’habiter l’espace et le temps autrement, en profondeur.
Sandrine Breithaupt