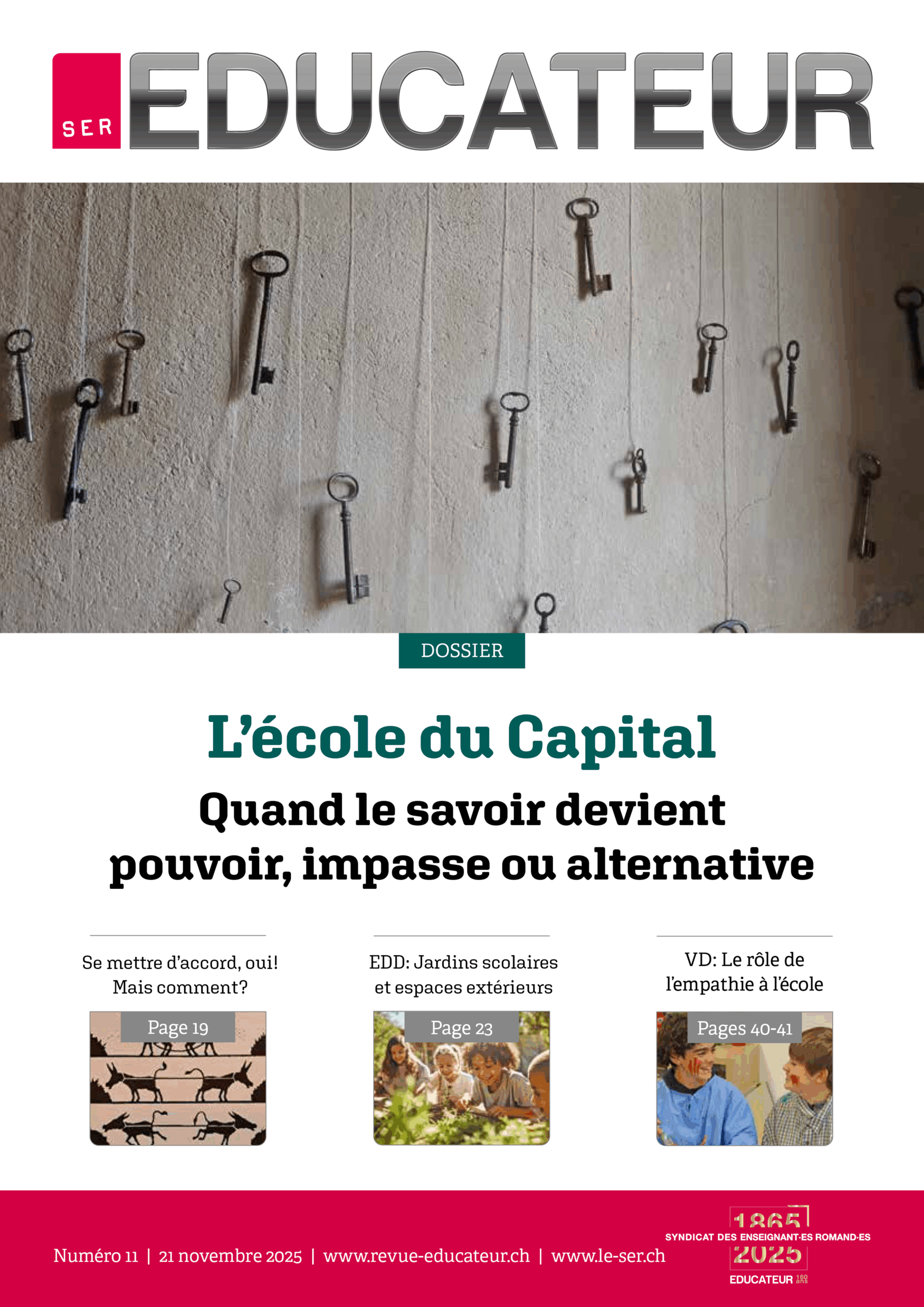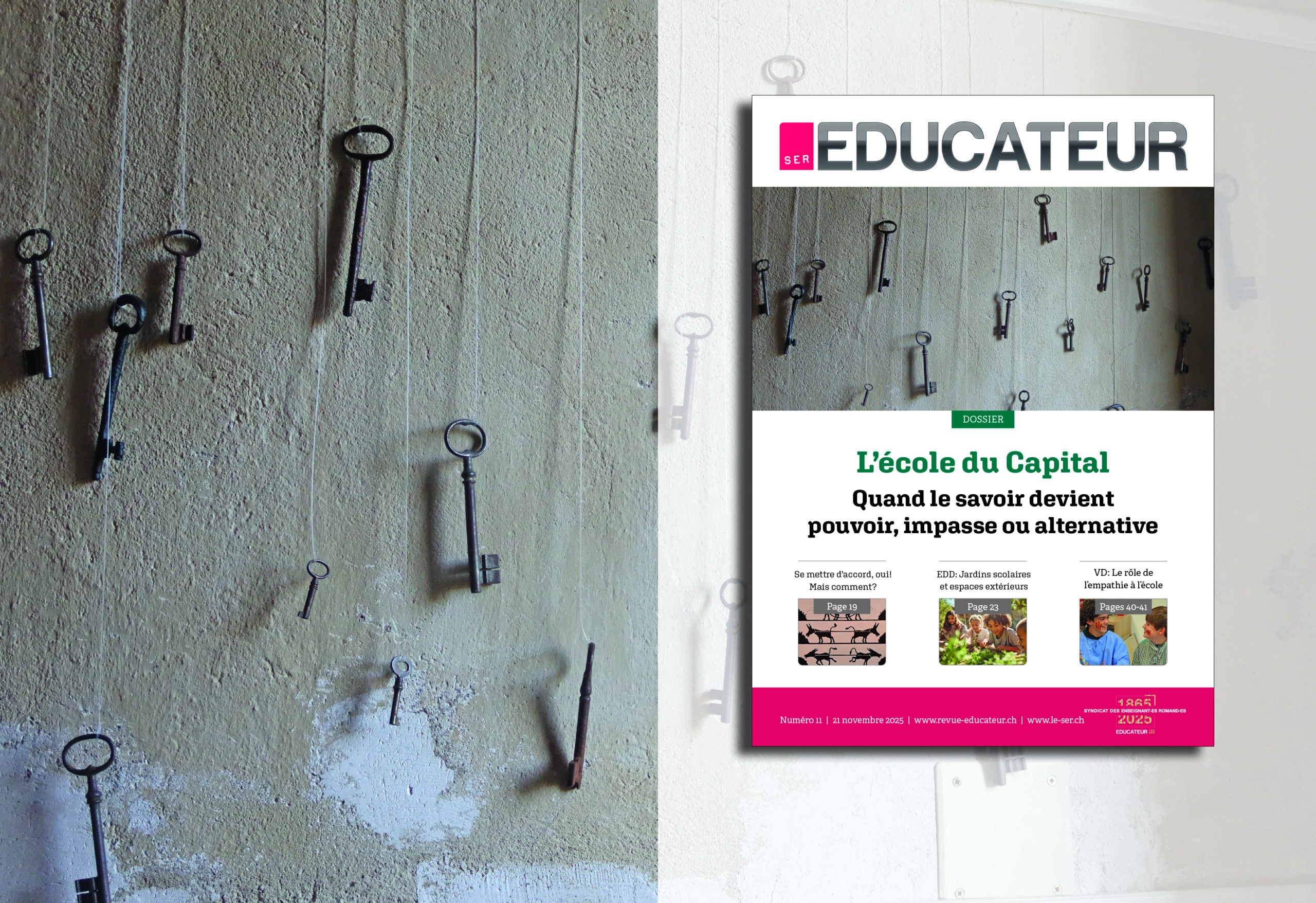L’école du Capital – Quand le savoir devient pouvoir, impasse ou alternative
Capitaliser les savoirs ? Pour qui ? Pourquoi ?
« Capitaliser » : l’expression s’impose aujourd’hui dans le vocabulaire de l’éducation comme un héritage du langage économique. Elle suggère qu’apprendre, enseigner ou former reviendrait à accumuler une richesse susceptible d’être conservée, valorisée et investie dans l’avenir.
Derrière cette métaphore séduisante, parce qu’elle évoque l’idée de croissance et de sécurité, se dessinent pourtant des enjeux beaucoup plus ambivalents : politiques éducatives arrimées à l’employabilité, dispositifs d’évaluation qui fonctionnent sur le modèle du crédit accumulé, injonctions à rendre visibles et traçables les acquis, rhétoriques de l’innovation ou de la gestion des compétences. Partout se déploie une logique de performance et de rentabilité qui semble réduire le savoir à une marchandise comparable aux autres.
Au-delà de la radicalité de cet état de fait, interroger la capitalisation des savoirs, c’est alors ouvrir un chantier. Car cette notion, loin de n’être qu’un outil neutre de gestion pédagogique, engage une manière de concevoir ce que sont l’éducation, la formation et l’émancipation. Dans les écoles obligatoires, les filières professionnelles, les universités, mais aussi au sein de mouvements d’éducation dits alternatifs, elle se décline et se transforme. Elle peut être vécue comme promesse d’ascension sociale, de reconnaissance et de mobilité. Mais elle peut aussi fonctionner comme contrainte et assignation, réduisant les apprentissages à leur seule valeur marchande, imposant aux individus de gérer leur parcours comme un portefeuille de compétences sans cesse actualisé.
Dès lors, plusieurs questions traversent ce dossier : que signifie accumuler des savoirs ? Quelles tensions surgissent entre les aspirations personnelles des apprenant·es, les injonctions sociales qui pèsent sur elles·eux et les politiques publiques qui organisent cette accumulation ? Quelles résistances, quelles alternatives ou quelles réinterprétations de la capitalisation sont possibles ?
Les contributions rassemblées ici offrent une pluralité de réponses. Elles posent des regards théoriques, critiques, empiriques et expérientiels. Certaines dénoncent l’emprise d’une logique néolibérale qui transforme les élèves en porteurs, porteuses de performance et vide l’école de son potentiel émancipateur. D’autres montrent comment la notion de compétence, aujourd’hui omniprésente, inscrit le savoir dans une économie de l’employabilité qui aurait aussi un certain avantage. D’autres encore examinent, au plus près des pratiques, comment rendre visibles les apprentissages sans les réduire à une simple comptabilité, ou comment l’écriture et les récits de vie deviennent des instruments de capitalisation émancipatrice, porteurs de dignité et de pouvoir d’agir.
L’enjeu n’est pas d’opposer frontalement accumulation et refus, mais de comprendre comment cette idée de capitalisation agit comme un voile sur nos manières d’apprendre et d’enseigner. S’agit-il de stocker des connaissances comme des biens figés ou de transformer l’expérience en ressources vivantes, partagées, ouvertes à la problématisation et à la coopération ? La tension est vive entre la tentation de réduire le savoir à un capital mort et la possibilité d’en faire un bien commun inépuisable.
Ce dossier invite ainsi à déplacer le regard. De l’école de la performance à celle de la coopération, des évaluations sommatives aux portfolios partagés, des compétences calibrées aux récits de vie, se dessine une interrogation commune : comment transmettre autrement, sans déposséder ? Comment donner à voir les apprentissages sans les enfermer dans des chiffres ou des cases ? Comment renouer avec l’idée que l’éducation ne se réduit pas à un investissement pour demain, mais qu’elle est déjà une expérience vécue, pleine de sens, de rencontres et de possibles ?
À travers les récits, analyses et expérimentations réunis, ce dossier de l’Educateur explore les chemins d’une éducation qui, plutôt que de capitaliser, émancipe, relie et transforme dans le même mouvement.
Zakaria Serir
AU SOMMAIRE
DOSSIER: coordonné par Zakaria Serir
Page 4: Quand l’école capitalise les savoirs, elle dépossède les élèves / Sandrine Breithaupt
Page 6: L’école comme marché des promesses / François Gremion & Zakaria Serir
Page 8: La notion de compétence / Tibère Schweizer
Page 10: Dans capitalisation, on entend « capital », un mot chargé d’histoire / Christian Yerly
Page 12: Le choix d’une capitalisation des savoirs ? Comme un voile posé sur nous … / Michel Neumayer
Page 14: Entre visibilité et climat d’apprentissage / Sarah Zerika
Page 15: S’emparer de l’écriture pour comprendre ce qui écrase / Pascale Lassablière
Page 17: Transformer l’école du XXI e siècle / Stefanie Rienzo , Clémence Neven , Sonia Vermeulen Steyaert , Elsa Goffart , Roxane Turgon , Ludivine Lenoir ,
Isabelle Vonèche Cardia , Rebecca Shankland , Frédéric Darbellay & Zoe Moody
MAGAZINE:
Page 19: Dialogue philo : Se mettre d’accord, oui ! Mais comment ?
Pages 20-21: Coulisses : La lecture, à l’épreuve du temps / Livre jeunesse : Pas touche à Charly ! / J’éduque, donc je lis
Pages 22-23: Cin’école : Deux héroïnes, deux passions : cuisine et fossiles au cinéma / EDD : Jardins scolaires et espaces extérieurs : bien plus qu’un potager
Pages 24-25: Enquêtes dessinées : Ces femmes pédagogues nos passeuses
Pages 26-27: Éducation aux médias : REPORTER : un jeu de plateau pour mener une enquête journalistique / En scène : Coups de théâtre sur le rivage
Pages 28-29: Prag’MITIC : Les identités numériques comme base de la formation / Formation professionnelle : Le grand dilemme du BYOD : outil d’apprentissage ou vecteur de distraction ?
Pages 30-31: Pédagothèque : Pierre Vianin, pédagogue des parents / Concours: LINGUISSIMO 2026 – « Trouver la sortie »
SER:
Pages 32-33: Le billet du président du SER : Pour une école qui ose ralentir – David Rey, président du SER
Page 48: Planète syndicale: Journée mondiale des enseignant·es : un avenir à défendre – David Rey
LES INFOS DES ASSOCIATIONS:
Pages 34-35: SEJ : Les épreuves communes en 8P n’en finissent pas d’alimenter les discussions – Christophe Girardin
Pages 36- 37: SEfFB : Le nombre de situations compliquées a augmenté – Sylvia Despont
Pages 38 - 39: SAEN : Le défi de la communication syndicale – Pierre-Alain Porret
Pages 40 - 41: VD : Le rôle de l’empathie à l’école ou quand apprendre rime avec comprendre – Arlinda Ramqaj
Pages 42-43: SPFF : Plan d’assainissement des finances cantonales (PAFE)
Pages 44-45: SPG : Quand l’inclusion sert de paravent à une politique de l’exclusion : douzième partie – Francesca Marchesini
Pages 46 - 47: SPVal & AVECO : Le deuxième mi-semestre se limite-t-il à l’évaluation ? – Olivier Solioz & Stéphane Darbellay