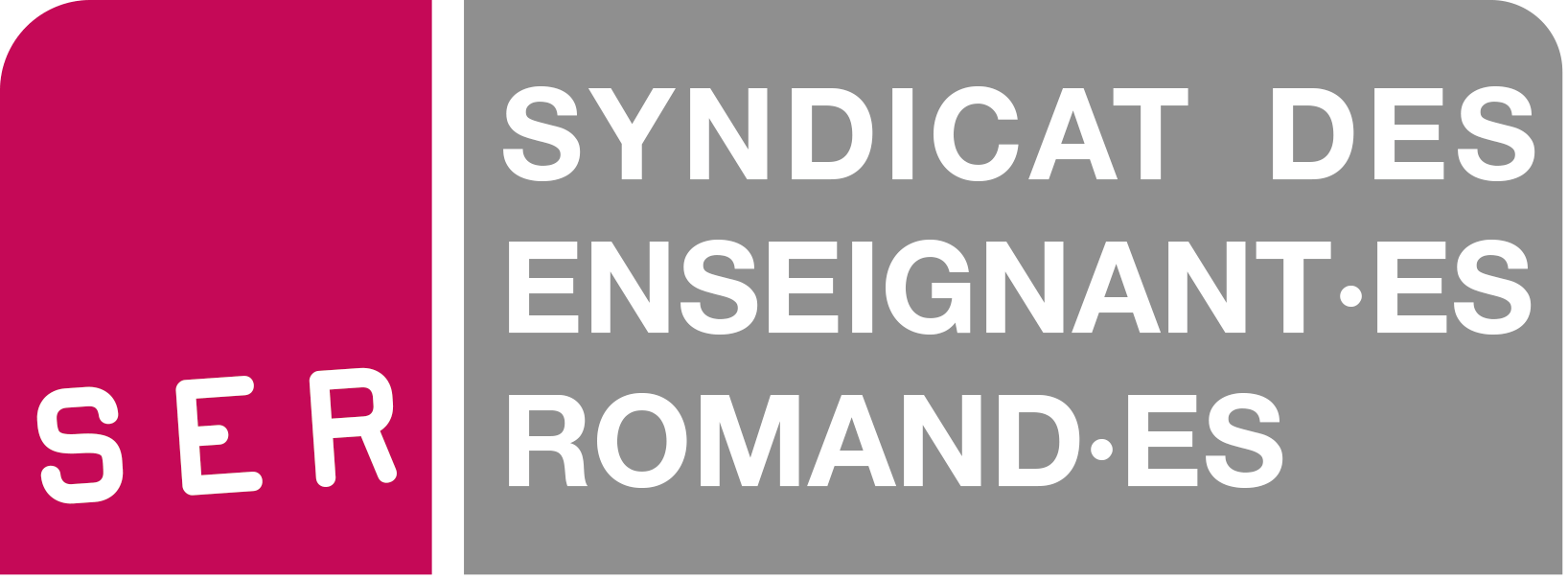L’inclusion confisquée : l’écart structurel entre discours et pratiques managériales
Pour comprendre pourquoi l’inclusion proclamée demeure une fiction, il faut interroger la configuration du champ scolaire, au sens où Bourdieu l’entendait : un espace traversé par des rapports de force et des hiérarchies symboliques, où les principes officiels se heurtent aux logiques pratiques de leur mise en œuvre. L’injonction à l’inclusion y opère comme norme légitime, mais dans un cadre organisationnel qui en neutralise la portée.
Les logiques néolibérales à l’œuvre dans l’institution imposent un dispositif fondé sur l’austérité, la compétition et l’assignation individuelle, tout en exigeant simultanément l’inclusion. Cette contradiction n’a rien d’accidentel : elle constitue, comme l’a montré Wendy Brown, une caractéristique structurelle d’un régime qui détruit les conditions de possibilité des valeurs qu’il prétend promouvoir.
Détachée de ses conditions matérielles – effectifs réduits, temps, coopération, stabilité des équipes, autonomie professionnelle –, l’inclusion devient un signifiant vidé de sa substance. Elle s’impose comme discours moral visant moins à transformer le réel qu’à maintenir l’illusion de la conformité du système à ses propres idéaux. Ce mécanisme produit une forme de violence symbolique redoutablement efficace : l’institution exige des enseignant·es ce qu’elle rend matériellement irréalisable, puis les désigne comme responsables de l’échec ainsi fabriqué. La vulnérabilité différentiellement distribuée, telle que l’analyse Butler, est ici pleinement à l’œuvre : une inclusion sans effectivité sélectionne, expose et sacrifie celles et ceux qu’elle prétend protéger.
Il faut le dire nettement : une école inclusive sans moyens n’est rien d’autre qu’une exclusion organisée. Et l’inclusion proclamée contre la parole du terrain n’est pas l’effet d’une absence de vision ; elle relève au contraire de la logique propre au néolibéralisme, qui dissimule sous un lexique émancipateur le démantèlement des conditions mêmes de l’inclusion.
La dépropriation du travail : l’obstacle structurel de l’inclusion
L’échec de l’inclusion ne s’explique pas seulement par le manque de moyens : il plonge ses racines dans un processus plus profond – la dépropriation du travail enseignant. Friot, Linhart, Framont l’ont montré : la domination néolibérale procède moins par privation que par captation du travail, par confiscation du sens, par mise sous tutelle de la maitrise professionnelle. À l’école, cette dépropriation prend des formes devenues routinières : inflation normative, bureaucratisation des gestes les plus simples, prolifération du reporting, rigidification temporelle, effacement des espaces de coopération, fragmentation des collectifs. Chaque réforme renforce cette dépossession – non par accident, mais parce qu’elle vise précisément à produire cette hétéronomie.
Or, l’inclusion suppose un véritable pouvoir d’agir : discerner, ajuster, inventer, coopérer. Elle est nécessairement située, relationnelle, contextuelle. Aucune procédure ne saurait produire l’inclusion. Un système qui réduit les enseignant·es à l’exécution de protocoles rend structurellement impossible la prise en compte effective d’élèves qui apprennent différemment, à des rythmes distincts, et nécessitent des réponses ajustées.
• On n’inclut pas en cochant des cases ;
• on n’adapte pas en suivant un script ;
• on ne coopère pas sous injonction hiérarchique.
L’inclusion exige du temps, du soin, de la délibération collective, un monde commun patiemment construit. La dépropriation – simultanément effet et ressort de la domination néolibérale – impose le rendement, l’urgence, la conformité et l’isolement, dépossédant les enseignant·es des dimensions vivantes de leur travail. Autrement dit : si l’inclusion s’affiche comme visée politique, la dépropriation du pouvoir décisionnel enseignant en constitue la négation matérielle.
La politique de l’abandon : fabrique ordinaire de l’exclusion scolaire
L’analyse butlérienne de la vulnérabilité – produite et hiérarchisée par les dispositifs du pouvoir – trouve chez Achille Mbembe son prolongement radicalisé : les régimes contemporains déploient des politiques de l’abandon, définies par une distribution sélective de la vulnérabilité qui consacre certaines vies à la protection et en relègue d’autres aux marges.
Cette logique, drapée dans les discours de l’efficience, de la modernisation ou de la rationalisation, établit une violence symbolique selon la définition de Bourdieu : un pouvoir qui, en dissimulant ses propres fondements historiques, parvient à naturaliser des inégalités pourtant entièrement produites.
L’inclusion telle qu’elle est aujourd’hui agencée participe de ce mécanisme. Non parce qu’elle manquerait seulement de ressources, mais parce qu’elle est déployée dans un dispositif organisationnel qui réduit les enseignant·es à un rôle d’exécutant·es et déplace la décision pédagogique vers des instances hiérarchiques parfois extérieures – lesquelles n’assument ni les responsabilités ni les conséquences sur le terrain.
Dans un tel cadre, l’inclusion produit inévitablement des catégories implicites d’élèves « intégrables » et d’élèves « relégué·es », non par choix pédagogique, mais par saturation structurelle : trop peu d’adultes, trop peu d’espace, trop peu de temps, trop peu de stabilité.
Ce tri implicite frappe d’abord les élèves les plus vulnérables, dont les trajectoires dépendent moins de droits garantis que d’une disponibilité humaine que les réformes assèchent méthodiquement. L’abandon n’a ici rien d’accidentel : il constitue l’effet systémique d’un dispositif qui érige la pénurie en norme.
Les politiques libérales déproprient le travail enseignant et sous-financent sciemment les services publics. Elles vident dès lors l’inclusion de toute effectivité et produisent, en pratique, une forme d’exclusion présentée sous les traits de l’égalité – une exclusion d’autant plus efficace qu’elle s’adosse à la fable méritocratique, qui convertit les inégalités structurelles en différences individuelles de mérite.
L’hypertrophie bureaucratique comme symptôme d’un pouvoir en perte de légitimité
Le renforcement des directions, la multiplication des MA, l’inflation normative et la rigidification bureaucratique ne relèvent pas seulement d’une incohérence managériale : ils signalent l’incapacité du pouvoir à produire un monde commun.
Lorsque l’autorité politique perd prise sur le réel, elle se replie sur les formes : elle substitue à la construction collective du sens une prolifération de prescriptions destinées à compenser symboliquement son propre dessaisissement. Comme l’ont montré Pierre Clastres, Claude Lefort et James C. Scott, plus une autorité est fragilisée, plus elle recourt à la procédure ; plus elle se déconnecte du terrain, plus elle multiplie les normes et renforce la verticalité, dans l’espoir de reconquérir une légitimité qui lui échappe.
Ainsi, ce que les autorités nomment « modernisation » n’est trop souvent que la mise en scène d’un pouvoir désinstitutionnalisé, cherchant à masquer son affaiblissement derrière des couches d’objectivation bureaucratique. Elles savent – confusément peut-être, mais réellement – que la reproduction quotidienne de l’école repose entièrement sur le travail enseignant. Tout le reste – organigrammes, tableaux de bord, strates hiérarchiques – fonctionne comme un écran destiné à dissimuler cette dépendance fondamentale. La verticalisation n’est donc pas le signe d’une puissance accrue : elle constitue au contraire le symptôme d’une fragilité structurelle. Un pouvoir qui ne peut plus gouverner par le sens tente inévitablement de gouverner par la procédure.
L’injonction inclusive dans un ordre capitaliste : une contradiction structurelle
Ainsi, l’école inclusive apparait structurellement incompatible avec un ordre capitaliste. Il ne s’agit pas d’un constat naïf ou idéaliste, mais d’une reconnaissance analytique : deux rationalités irréductibles traversent et structurent aujourd’hui le système scolaire, l’une ordonnée à la valorisation marchande, l’autre aux conditions mêmes de la relation éducative :
• Le capitalisme institue la rareté ; l’inclusion suppose des ressources humaines et organisationnelles réellement disponibles et autonomes.
• Le capitalisme érige la compétition en principe ; l’inclusion repose sur la coopération.
• Le capitalisme fragmente les collectifs ; l’inclusion exige des communautés éducatives solides et solidaires.
• Le capitalisme valorise l’urgence et le rendement ; l’inclusion requiert du temps, du soin et de l’attention.
Dans ces conditions, les politiques actuellement menées ne sauraient produire l’inclusion : elles n’en orchestrent que le simulacre, préservant l’apparence d’un système dont les fondements se fissurent.
La réaction de la CIIP en 2024 en fournit l’illustration manifeste : non un geste d’autorité, mais l’aveu d’un pouvoir qui ne parvient plus à stabiliser son propre récit – ce moment précis que Gramsci nomme crise hégémonique.
Nous y sommes.
Si le pouvoir se crispe, c’est qu’il voit vaciller les bases de sa domination symbolique. Et si nos mobilisations se multiplient, c’est que les rapports de force qu’il croyait stabilisés commencent à se déplacer.
C’est dans ces brèches – fragiles, mais bien réelles – que s’esquisse déjà une politique vivante d’émancipation.
Francesca Marchesini, présidente de la SPG