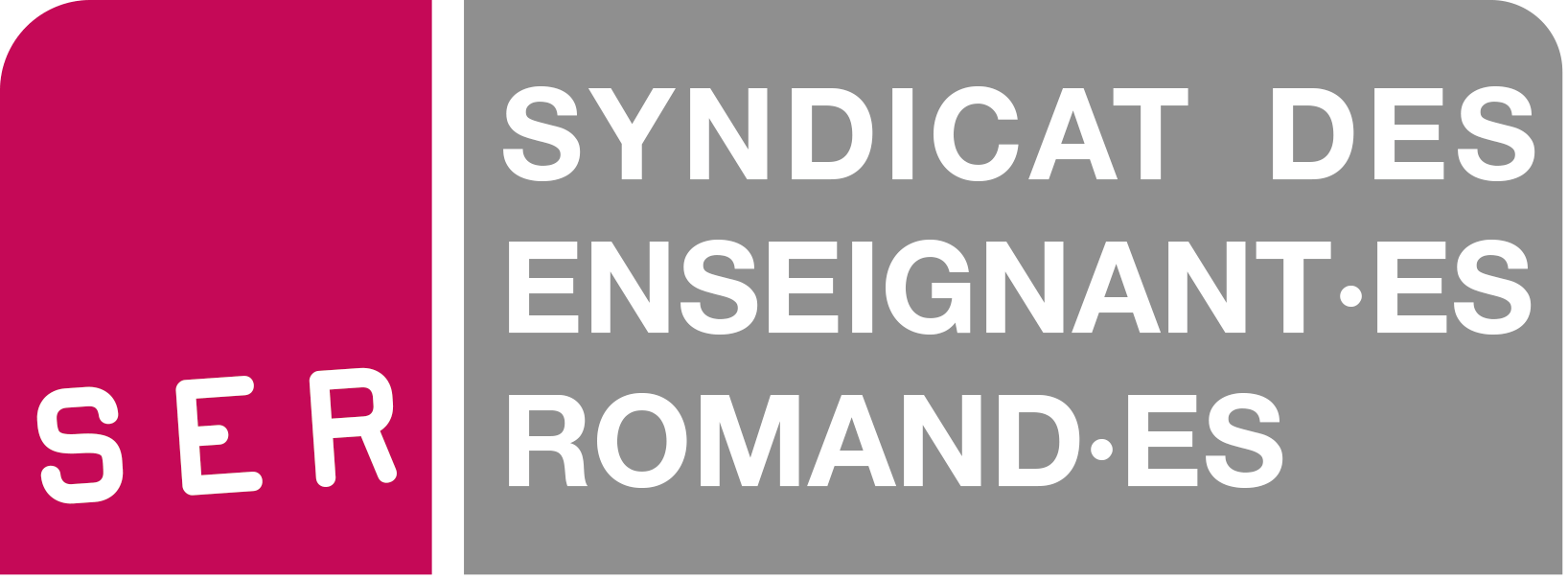Ces derniers mois, à travers notamment le concept d’hégémonie culturelle, j’ai entrepris d’analyser comment la classe dirigeante œuvre à la délégitimation de nos revendications et en quoi des réactions vives, à l’instar de celle de la CIIP face à un simple communiqué de presse, s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à présenter les enseignant·es comme des privilégié·es et leurs représentant·es comme des figures excessives dont l’irrationalité servirait des intérêts corporatistes et particularistes, supposément contraires à l’intérêt général. Avant de proposer quelques pistes d’actions concrètes pour renouer avec notre pouvoir d’agir, il apparait nécessaire de procéder à une clarification conceptuelle. Ce travail préliminaire impliquera une définition rigoureuse de plusieurs notions fondamentales : le travail, le capitalisme, le rôle de l’État dans un système capitaliste et le communisme comme réponse révolutionnaire. Il ne s’agira pas d’envisager ce dernier sous l’angle des expériences politiques qu’il a connues en Chine ou en Russie, mais bien d’en restituer la conceptualisation originelle telle que théorisée par Karl Marx.
Le travail comme terrain de lutte : au-delà de la délégitimation, une réappropriation nécessaire
Si la pensée d’Antonio Gramsci nous exhorte à reprendre le contrôle du discours sur notre métier, le sociologue Bernard Friot et le philosophe Bernard Vasseur, dans leur ouvrage Le communisme qui vient, insistent sur l’urgence de replacer la question du travail au cœur des luttes de la gauche. Historiquement, celles-ci se sont essentiellement focalisées sur la redistribution des richesses sans interroger les structures mêmes du travail sous le capitalisme. Or, cette approche réductionniste occulte une réalité fondamentale : le travail ne constitue pas uniquement un enjeu économique, mais avant tout le lieu où se structurent et se reproduisent les rapports de pouvoir. Comme le souligne Karl Marx, « le capitalisme n’est pas d’abord une économie – une fabrique de choses à faire circuler et à consommer –, il est avant tout une fabrique de pouvoir sur les humains, dans le travail qu’il a capturé, auquel il les condamne et dans lequel il les asservit ». Dès lors, il est impératif de repenser le travail non plus comme une simple marchandise, mais comme un processus socialement et politiquement déterminé, devant être réhabilité en tant qu’activité structurante de l’émancipation individuelle et collective, orientée vers l’intérêt général et la construction du bien commun. Ainsi, la finalité du travail ne saurait être dictée par une rationalité strictement marchande fondée sur l’accumulation du capital, mais devrait être évaluée selon le prisme de son utilité sociale et de son adéquation avec les impératifs écologiques et sociétaux.
Pourtant, dans le système actuel, comme le dénoncent Friot et Vasseur, « les travailleurs et travailleuses ne décident pas : ils sont réduits à l’état d’instruments auxquels le travail est imposé, des instruments jugés couteux, dont il s’agit en permanence de limiter le nombre ». Ce constat met en lumière l’existence d’un mode de production organisé non pas en fonction de l’intérêt général ou des besoins sociaux, mais selon des impératifs structurels de rentabilité et de maximisation du capital. Cette dynamique destructrice ne se limite pas à l’industrie ou aux services marchands: elle s’étend également aux sphères non marchandes, notamment à l’éducation et aux services publics, où la rationalisation budgétaire et la mise en concurrence des établissements participent d’un processus global de dépossession du pouvoir des travailleurs et travailleuses sur leur propre activité. Dès lors, il devient impératif d’analyser ces dynamiques afin d’identifier les leviers permettant une réappropriation du travail en tant qu’espace de souveraineté collective et de transformation sociale.
L’État, garant du capital : reconquérir le pouvoir sur le travail
L’État ne saurait constituer un levier d’émancipation tant qu’il demeure structurellement inféodé aux logiques du capital. Loin d’être un arbitre impartial, il constitue un rouage essentiel de la préservation de l’ordre établi, assurant la pérennisation des rapports de domination. Comme le soulignent Friot et Vasseur, l’État orchestre, par la contrainte, une vaste spoliation, celle d’un « divorce entre les travailleurs et la propriété des conditions de
réalisation du travail ». Dès lors, l’émancipation ne peut se limiter à une conquête du pouvoir institutionnel : elle suppose un renversement des rapports de production au sein même du travail, espace stratégique où se cristallisent et se reproduisent les logiques de domination. « Autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’élire des dirigeant·es politiques, mais bien d’obtenir le pouvoir de décision sur le travail. Dès lors, la bataille ne peut être réduite aux seules échéances électorales. »
Ainsi, dépasser les limites imposées par la politique institutionnelle implique d’intégrer le travail à la définition même de la citoyenneté. Cette approche impose une refonte des cadres traditionnels du combat politique : la lutte pour l’émancipation doit se mener en priorité sur le terrain du travail.
C’est donc au sein du travail que doit émerger une véritable démocratie économique, fondée sur l’auto-organisation et l’autogestion, en rupture avec les logiques d’exploitation et de dépossession. Comme le formulent Friot et Vasseur : « Il s’agit bien d’en finir avec exploitation, domination et injustices et d’organiser un « libre développement des individus », en ouvrant la voie à une auto-organisation, une autogestion qui ne puisse pas échapper à la conviction entièrement démocratique qui l’impulse et constituer ainsi vraiment une émancipation. » Dès lors, l’émancipation ne peut être décrétée d’en haut : elle exige l’initiative collective des travailleurs et travailleuses, pleinement acteurs de leur propre libération : « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes et de personne d’autre à leur place. »
Le communisme : une lutte en acte, ici et maintenant
L’évocation du communisme peut susciter des interrogations et des réticences, en raison de son assimilation aux expériences historiques de la Russie ou de la Chine. Pourtant, confondre le communisme chinois avec un projet d’émancipation relève d’une erreur conceptuelle comparable à celle qui consisterait à qualifier le national-socialisme allemand de socialisme. Le communisme n’est ni une utopie hors-sol ni une simple projection idéalisée dans un avenir incertain : il se construit dès à présent, dans les luttes sociales qui s’opposent aux logiques d’exploitation et de dépossession. Il prend racine au sein même du capitalisme, en révélant ses contradictions internes et en ouvrant ainsi la voie à son dépassement. Comme le soulignent Friot et Vasseur : « Le communisme n’est pas le stade terminal d’un mouvement de conquêtes sociales, mais bien plutôt l’existence en acte d’une ambition collective se faisant sujet de sa propre existence en s’engageant consciemment – pour la première fois dans l’histoire des sociétés – à balayer l’ordre existant pour donner toute sa dimension à une civilisation universelle pleinement humaine. Loin d’être une abstraction idéologique, le communisme s’incarne déjà dans les conquêtes sociales arrachées de haute lutte. Chaque victoire syndicale, chaque conquis social, chaque espace soustrait à la logique marchande constitue un pas concret vers un horizon communiste, autrement dit « un monde nouveau » est en formation au sein du « monde ancien », où il se fortifie tout en travaillant à le nier jusqu’à le dépasser. » Ainsi, la question n’est pas de savoir si le communisme est possible, mais de reconnaitre les forces qui œuvrent déjà à son émergence. L’enjeu est de consolider ces avancées, de les amplifier et de les généraliser, jusqu’à ce qu’elles ne soient plus des exceptions, mais la norme.
Ces dynamiques s’inscrivent dans une histoire longue de luttes, témoignant que l’avenir communiste est déjà en gestation : « L’avenir communiste a fait de premiers pas, il a déjà commencé et nous ne sommes pas des nouveau-nés : on s’est battus depuis des lustres et les luttes des classes n’ont pas connu que des stagnations ou des échecs. » En valorisant ces avancées concrètes, en nous appuyant sur les « déjà-là » communistes, nous pouvons rompre avec la posture victimaire dominante, qui alimente l’impuissance politique et sociale. Le capitalisme n’a rien d’indépassable, de rationnel ou de souhaitable. Comme le rappellent Friot et Vasseur : « À l’heure de la mondialisation du capitalisme et au temps où ce qui est à l’ordre du jour n’est pas seulement un changement de société mais une véritable bifurcation de civilisation, à l’heure où existent des conquis sociaux décisifs et où sont établis (même menacés) des déjà-là communistes, le combat communiste n’est plus l’exclusivité d’un parti d’avant-garde. » L’émancipation des travailleurs et travailleuses passe nécessairement par une réappropriation du travail lui-même. Dans cette perspective, les enseignant·es doivent replacer le contenu du travail éducatif au centre des revendications, pour renouer avec leur pouvoir d’agir. La suite de cette réflexion s’attachera ainsi à examiner les « déjà-là » communistes sur lesquels les enseignant·es peuvent s’appuyer pour faire du contenu de leur travail un levier de transformation sociale, au service d’une école véritablement inclusive.
Francesca Marchesini, présidente de la SPG