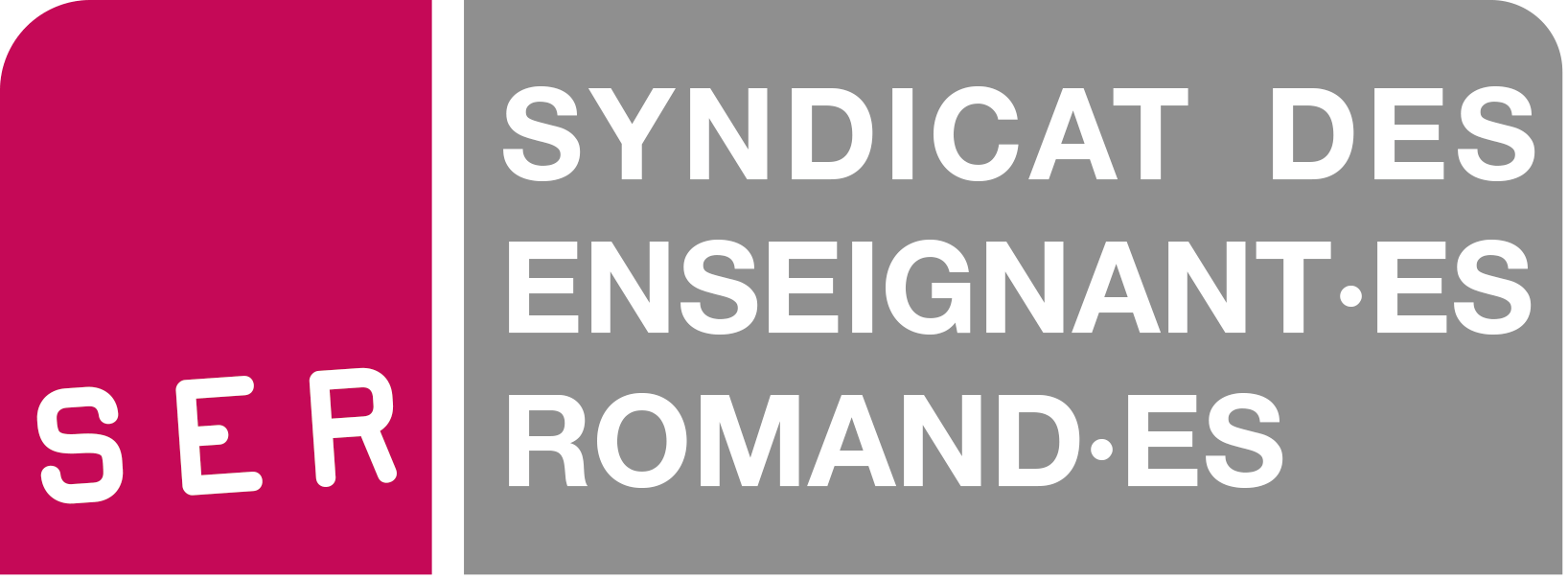Reprendre la main sur le travail : un enjeu révolutionnaire
Ces derniers mois, j’ai examiné les attaques persistantes dirigées contre l’institution scolaire, mettant en évidence la manière dont la classe dominante mobilise des logiques de marchandisation et de gouvernance managériale afin d’éroder les fondements mêmes de la profession enseignante. En m’appuyant sur les apports théoriques de Friot et Vasseur, j’ai montré que ces offensives ne se réduisent pas à de simples coupes budgétaires : elles visent en réalité à délégitimer les formes collectives, coopératives et démocratiques du travail éducatif au sein des établissements. Ce constat appelle la réappropriation par les enseignant·es de leur autonomie professionnelle et de leur pouvoir d’agir collectif. Dans ce contexte, il devient en effet essentiel par exemple de réaffirmer la valeur du statut de fonctionnaire, non comme un privilège, mais comme la condition structurelle d’un exercice libre et responsable de la mission éducative dans un cadre démocratique.
Faire de l’école un lieu pleinement émancipateur, affranchi des logiques instrumentales et hiérarchiques du capitalisme contemporain, constitue un enjeu décisif dans toute perspective de transformation sociale. Il appartient aux professionnel·les de l’éducation de revendiquer leur légitimité épistémique et politique, d’exiger une reconnaissance pleine de leur compétence et de contester toute forme de subordination qui viendrait réduire leur action à une exécution technique. Comme l’affirme le syndicaliste suisse Christian Tirefort, « seul·es les travailleur·euses créent du travail, lorsqu’ils et elles exercent souverainement leur faculté de faire ». Cette affirmation entre en tension directe avec la conception hétéronome du travail promue par les logiques capitalistes, dans laquelle les travailleur·euses sont assigné·es à une position d’obéissance, dépossédé·es du contenu et du sens de leur activité, exécutant des tâches prescrites dans un cadre qui leur échappe.
L’éducation, dès lors qu’elle se réduit à une série de prescriptions normées et déconnectées des réalités de terrain, devient un espace d’aliénation. Elle doit au contraire se reconstruire comme un lieu de subjectivation, de transmission vivante et de coopération éclairée. Elle ne saurait se résumer à un service administratif parmi d’autres : elle est l’un des rares espaces sociaux capables d’ouvrir des brèches dans la rationalité utilitariste dominante, en favorisant un rapport au travail fondé sur la finalité sociale, la coopération, et l’épanouissement des individus. En désignant le travail comme le site même de la domination capitaliste, Marx a tracé les linéaments d’une voie d’émancipation. Il ne s’agit donc pas simplement de défendre l’école publique comme un acquis institutionnel, mais de la refonder comme un espace politique, réflexif et créateur, capable de porter un horizon démocratique renouvelé. L’avenir de l’éducation ne se joue pas uniquement dans les rapports de force institutionnels : il dépend aussi de la capacité des acteur·trices de terrain à se réapproprier les finalités, les méthodes et les conditions d’exercice de leur métier. Dans cette reconquête réside un enjeu véritablement révolutionnaire.
Les dynamiques hiérarchiques et l’institutionnalisation de la violence au travail
Historiquement, comme l’analysent également Friot et Vasseur, les forces progressistes — en particulier la gauche politique et les mouvements syndicaux — ont porté des projets ambitieux de transformation sociale, fondés sur les principes de l’autogestion, de la démocratie économique et de la coopération. Cependant, ces idéaux ont progressivement perdu de leur centralité dans le débat public, laissant la question des modalités concrètes du travail — et plus spécifiquement celle des conditions dans lesquelles il s’effectue — sous la régulation exclusive des directions d’entreprises. Ces dernières, confrontées à une démotivation croissante et à un désengagement manifeste des salarié·es, privilégient malheureusement des réponses cosmétiques, cherchant davantage à masquer une exploitation systémique, consubstantielle au fonctionnement du capitalisme contemporain. Pour le sociologue français, Nicolas Framont, il est indispensable de rouvrir ce chantier critique, non pas dans une perspective réformiste, mais dans une optique de refondation radicale des rapports de production, visant l’émancipation réelle des travailleur·euses et la reconnaissance pleine de leur humanité au sein même de l’organisation du travail.
Framont documente l’émergence et la consolidation d’une culture managériale hégémonique qui érige la violence au travail en norme implicite. Dans ce cadre, les structures hiérarchiques — souvent dénuées de légitimité fonctionnelle ou démocratique — produisent des effets de souffrance psychique et physique d’une ampleur structurelle. Cette violence, qu’il qualifie d’artefact sociohistorique, apparait comme le produit d’un système d’oppression orchestré par une minorité dominante, déterminée à maximiser les profits au mépris absolu de la dignité des travailleur·euses. Ce dispositif, profondément enraciné dans les structures sociales, s’inscrit dans une histoire longue de dépossession et de contrainte, prenant racine dans les logiques capitalistes classiques, tel que le mouvement des enclosures décrites par Marx : ce moment de rupture brutale où des populations entières furent contraintes à l’acceptation du salariat, souvent dans un contexte de répression ouverte et de violence institutionnalisée. Dans le contexte contemporain, cette logique ne s’est pas estompée ; elle s’est transformée, se drapant désormais dans le langage du management et de l’expertise technocratique. Dans le champ étatique et scolaire, cette mutation se manifeste par une verticalisation accrue des dispositifs hiérarchiques, par un renforcement des pouvoirs dévolus par exemple aux directions d’établissement, et ce, sous couvert d’autonomisation des structures et d’optimisation de leur prétendue performance. Pourtant, depuis que les notions d’« efficience » et d’« efficacité » se sont imposées dans le lexique institutionnel, il apparait que le système n’a jamais été aussi dysfonctionnel et contre-productif pour celles et ceux qui y travaillent. L’érosion de la cohérence du service public ne fait que refléter la vacuité de ces référentiels gestionnaires, incapables de répondre aux besoins réels du terrain.
Par ailleurs, l’État-employeur adopte désormais une posture de dissimulation cynique de ses responsabilités, se comportant comme s’il ne portait aucune obligation envers ses agent·es, traité·es comme des exécutant·es tenus·es de se conformer à des prescriptions unilatérales. Cette représentation s’appuie sur une rhétorique insidieuse selon laquelle le statut de fonctionnaire constituerait un privilège exorbitant, rendant suspecte toute revendication légitime de droits fondamentaux. Or, les enseignant·es ne sauraient être réduit·es à de simples bénéficiaires d’un statut protecteur car iels portent une mission d’intérêt général. À ce titre, iels doivent pouvoir exercer leur activité dans un cadre respectueux de leur santé, de leur autonomie et de leur dignité. Il revient à l’État, en tant qu’employeur, de garantir ces conditions — une responsabilité qu’il néglige de manière systématique, tout en rappelant avec rigueur les obligations qui pèsent sur ses agent·es. Ce déséquilibre, qui confine à l’absurde, contribue à l’étouffement progressif des droits effectifs des travailleur·euses, lesquels se trouvent de plus en plus souvent réduits à des formules vides de sens.
Le néomanagement éducatif : entre injonctions productivistes et régression démocratique
Ainsi, loin d’un processus de progrès linéaire et consensuel, les transformations contemporaines du monde du travail mettent en lumière la persistance structurelle de mécanismes d’exploitation, dissimulés sous les apparences séduisantes de l’innovation organisationnelle et de la modernisation managériale. La hiérarchie, loin de se réduire à un instrument neutre de coordination, constitue un véritable dispositif de pouvoir, issu d’un héritage historique colonial et tayloriste, aujourd’hui renouvelé et amplifié par les technologies de surveillance ainsi que par les rationalités néolibérales. À Genève, les récentes modifications du cahier des charges des maitre·sses adjoint·es (MA), imposées unilatéralement en dépit de l’opposition exprimée par la SPG, ainsi que les révisions du règlement RStCE (Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant), témoignent d’un resserrement autoritaire de la gouvernance scolaire. Ces décisions traduisent une accentuation de la verticalité hiérarchique, une augmentation implicite du temps de travail et une réduction corrélative des marges d’autonomie professionnelles. La grève du temps de travail hors présence des élèves — et plus spécifiquement celle des temps de travail collectif (TTC) — décidée lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2025, a mis en évidence la manière dont la DGEO et les directions régionales (DIR-E) tentent de s’approprier unilatéralement l’organisation du travail enseignant. En imposant l’agenda des séances de travail ainsi que les thématiques abordées, elles minent le principe d’autonomie pédagogique et vident de leur sens les temps de concertation.
Dans les prochaines publications, j’approfondirai cette critique en examinant les impasses du management contemporain, que l’on peut qualifier de véritable dispositif de dissolution des collectifs : une mécanique d’opacité des responsabilités, d’individualisation des contraintes, et d’institutionnalisation de la souffrance au travail. J’analyserai également l’intensification des formes de contrôle à travers les outils numériques, qui tendent à réifier l’acte pédagogique en le réduisant à une production normée, quantifiable et décontextualisée, niant par là même sa dimension relationnelle, éthique et humaine. Enfin, je poursuivrai ma réflexion en direction d’une critique systémique, orientée vers la mise en lumière d’alternatives concrètes, déjà expérimentées dans certains contextes professionnels : formes de coopération horizontale, espaces d’auto-organisation, processus de réappropriation collective de la décision. Ces pistes ne relèvent pas de l’utopie abstraite. Elles émanent d’une nécessité urgente, profondément ancrée dans l’expérience quotidienne du terrain : celle de reprendre la main sur nos pratiques et notre dignité professionnelle. Il ne s’agit plus seulement de résister. Il s’agit désormais de délégitimer l’ordre imposé, de déconstruire les dogmes managériaux, et de réinventer le travail sur des bases radicalement autres : égalitaires, démocratiques et solidaires.
Francesca Marchesini, présidente de la SPG