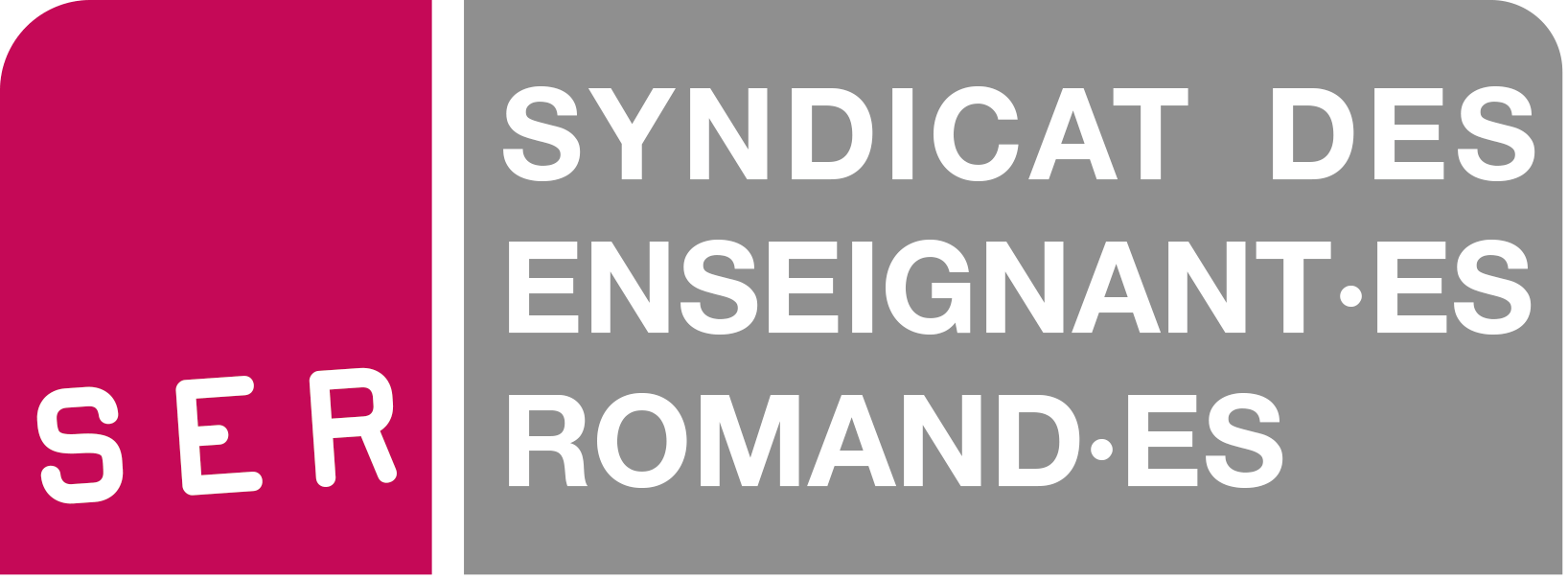Alors que l’école publique est soumise à une déstabilisation systémique so us couvert d’efficience et de modernisation, l’analyse syndicale met en lumière la réalité d’une dépossession professionnelle organisée. Derrière les logiques managériale s imposées par le DIP c’est un véritable processus de désinstitutionnalisation qui s’enclenche : verticalisation autoritaire, hiérarchies déresponsabilisées, dilution des col lectifs éducatifs. La directive sur le temps de travail des enseignant illustre la mise sous tutelle de l’autonomie enseignante par le renforcement de directions d’établissem ent sans légitimité pédagogique, outillées davantage pour contrôler que pour soutenir.
Ce pouvoir hiérarchique, hérité des logiques esclavagistes et tayloristes, s’exerce sans contre-pouvoir, tout en invisibilisant ses propres responsabilités. L’institution abandonne les enseignant·es aux abus, constitue les directions et les MA en relais dociles d’un autoritarisme croissant, et organise la disqualification systématique de celles et ceux qui sont vraiment responsables des élèves qui leur sont confié·es. Il est donc temps de remettre au centre du débat la démocratie professionnelle, la justice au travail, et la souveraineté pédagogique des enseignant·es.
Aliénation collective et perte du sens du travail
Le travail, tel qu’il est conçu et structuré dans la société contemporaine, ne se contente pas de produire de la souffrance psychique et physique ; il dépossède les travailleurs et travailleuses de toute expérience collective, solidaire et joyeuse — celle-là même qu’il pourrait, et devrait, incarner. Dans des conditions véritablement coopératives, le travail devient un espace d’émancipation, de créativité partagée, une dynamique que l’anthropologue David Graeber qualifie d’intrinsèquement « communiste ». Or cette puissance transformatrice est méthodiquement détruite par les logiques gestionnaires dominantes, qui isolent les individus et les soumettent à une quête d’efficience aussi stérile que destructrice.
Le sociologue Nicolas Framont met en lumière l’hypocrisie fondamentale du discours capitaliste, qui prétend fonder le contrat de travail sur un accord entre individus libres et égaux. Une fiction juridique qui masque un rapport de domination, inscrit dans la subordination salariale et amplifié par la précarité matérielle. Ce lien de pouvoir, fondamentalement asymétrique, se dissimule sous des euphémismes tels que « collaborateurs », pendant que la contrainte économique, omniprésente, dicte unilatéralement les termes de l’engagement. Ce discours enrobe une domination brutale, fardée en coopération volontaire.
Aujourd’hui, la violence structurelle du modèle organisationnel scolaire s’incarne de manière tangible et constante sur le terrain. Un mal-être diffus, mais profondément enraciné, gangrène les établissements scolaires genevois, générant des tensions croissantes entre collègues — en particulier dans les écoles primaires et au sein des structures de l’OMP. Cette souffrance professionnelle, loin d’être un phénomène conjoncturel ou subjectif, relève d’un diagnostic collectif solidement documenté : les résultats de l’enquête menée auprès du personnel viennent confirmer ce que les associations professionnelles dénoncent uniment depuis des années. Pourtant, cette parole est constamment tenue à distance, dévalorisée, voire méprisée par une institution sourde aux alertes des représentant·es du personnel.
Briser les carcans pour libérer l’école
La SPG a, à maintes reprises, mis en lumière les impasses d’un système à bout de souffle et l’impérieuse nécessité d’engager une réflexion collective ambitieuse pour refonder une école régulière à la fois plus inclusive pour les élèves et plus respectueuse des enseignant·es. Ces deux dimensions sont intrinsèquement liées : l’absence de reconnaissance pleine et entière du professionnalisme du personnel éducatif — trop souvent relégué en marge des décisions, invisibilisé, voire naturalisé en vertu d’une tradition féminisée du métier — entrave la possibilité d’un accompagnement pédagogique juste, différencié et réellement inclusif. Au cœur de cette crise, l’un des nœuds structurels majeurs réside dans la rigidité extrême des horaires, en particulier au cycle 2. Ce carcan temporel entrave l’organisation des décloisonnements pédagogiques, étouffe les dynamiques collaboratives et condamne les équipes enseignantes à l’isolement fonctionnel. Or les décloisonnements ne relèvent pas d’un simple confort professionnel : ils constituent le levier fondamental d’une école véritablement inclusive. En permettant de travailler au plus près des besoins des élèves, dans le respect de leurs besoins et rythmes singuliers — et non en fonction de leur âge ou de leur degré scolaire —, ils brisent la logique normative de tri et d’assignation qui structure encore trop souvent l’école ordinaire. Il ne s’agit donc pas simplement d’adapter l’école aux besoins différenciés des élèves, mais bien d’instaurer les conditions concrètes d’un agir pédagogique collectif, pensé à partir des élèves, et non des cases institutionnelles. Il s’agit également de restaurer une intelligence professionnelle partagée, affranchie des logiques hiérarchiques et productivistes, à la hauteur des exigences démocratiques, sociales et humaines que porte l’école publique.
De la grève des TTC à la réappropriation
de notre métier
Il est non seulement légitime mais urgent de restaurer un pouvoir décisionnel effectif aux équipes pédagogiques. Ce pouvoir doit s’exercer notamment en matière de répartition des ressources, d’organisation du travail et de définition des priorités pédagogiques. La mobilisation actuelle — et en particulier la grève du temps de travail hors présence des élèves — révèle crûment la dérive autoritaire par laquelle la DGEO et les directions d’établissement se sont progressivement approprié le contrôle de notre organisation professionnelle. Depuis quand les directions se sont-elles arrogées le droit de fixer unilatéralement le contenu, la fréquence, voire la finalité de nos réunions ? Depuis quand peuvent-elles décider avec qui nous collaborons, et selon quelles modalités relationnelles ou pédagogiques ? Pourquoi l’attribution des ressources pédagogiques — humaines, matérielles, temporelles — échappe-t-elle de plus en plus à toute délibération collective et démocratique ?
Ces questions profondément politiques mettent en jeu le sens même du métier, la qualité du service public et la place du collectif dans l’institution scolaire. Il ne s’agit plus seulement de revendiquer quelques aménagements à la marge : il s’agit de reprendre ce qui nous a été méthodiquement confisqué — notre autonomie professionnelle, notre dignité collective, notre droit inaliénable à un travail humainement vivable et pédagogiquement juste.
Face à l’autoritarisme technocratique,
la SPG maintient une exigence de rigueur
démocratique
Dans le prolongement de la directive imposée unilatéralement sur le temps de travail — et à la lumière des constats sans appel issus de l’enquête de satisfaction conduite par le Département lui-même — la SPG a formulé une série d’exigences précises, appuyées sur une analyse rigoureuse des réalités professionnelles. En effet, loin d’apporter la clarté annoncée, ladite directive introduit une complexité inutilement artificielle, fondée sur des postulats mathématiquement erronés, et révèle une méconnaissance persistante du travail réel des professionnel·les du terrain.
Toutefois, dans un esprit de responsabilité stratégique — sans renoncer à aucun des principes fondamentaux d’équité et d’autonomie professionnelle — la SPG a posé les conditions minimales d’un éventuel apaisement du conflit. Ces exigences incluent : la redéfinition du rôle des enseignant·es dans l’enseignement spécialisé ; un encadrement effectif des dérives managériales ; la réouverture du chantier de l’horaire scolaire, sans tabou ni restriction préalable ; la reconnaissance d’un véritable pouvoir décisionnel au sein des équipes ; ainsi que la revalorisation structurelle de la formation continue sur le temps scolaire.
Si le Département prétend ne pas vouloir alourdir la charge de travail, il lui appartient désormais d’en administrer la preuve par des mesures concrètes et opposables. À défaut, la mobilisation collective sera reconduite et renforcée. Une réponse formelle de la conseillère d’État est attendue dans le courant de l’été sur la base de laquelle les membres de la SPG, réuni·es en Assemblée des délégué·es ou en Assemblée générale, se prononceront en toute souveraineté à la rentrée.
Reprendre la main, réinstituer le sens
Ainsi, la mobilisation en cours dépasse de loin les seuls enjeux conjoncturels. Elle s’inscrit dans une dynamique plus profonde : celle d’une résistance à l’infantilisation institutionnelle, à la dépossession silencieuse, et à cette gouvernance managériale qui transforme l’école en dispositif de contrôle plutôt qu’en espace de construction partagée. Reprendre la main sur notre métier, revient à restaurer du sens là où l’institution génère de l’absurde, du vide et de l’usure administrative. Ce dont l’école a besoin, ce ne sont pas d’ajustements technico-règlementaires, mais d’un renversement politique clair : un renversement qui réaffirme la primauté du collectif sur l’autorité, du soin pédagogique sur l’obsession évaluative, de l’autonomie sur l’assignation. Il ne s’agit pas de corriger les marges d’un système défaillant, mais de refonder l’école depuis son centre névralgique : celles et ceux qui la font vivre chaque jour, dans les classes, auprès des élèves. Ce que la hiérarchie tente de confisquer, les enseignant·es doivent le reconquérir ensemble — non comme une faveur concédée, mais comme un droit désormais revendiqué.
Francesca Marchesini, présidente de la SPG