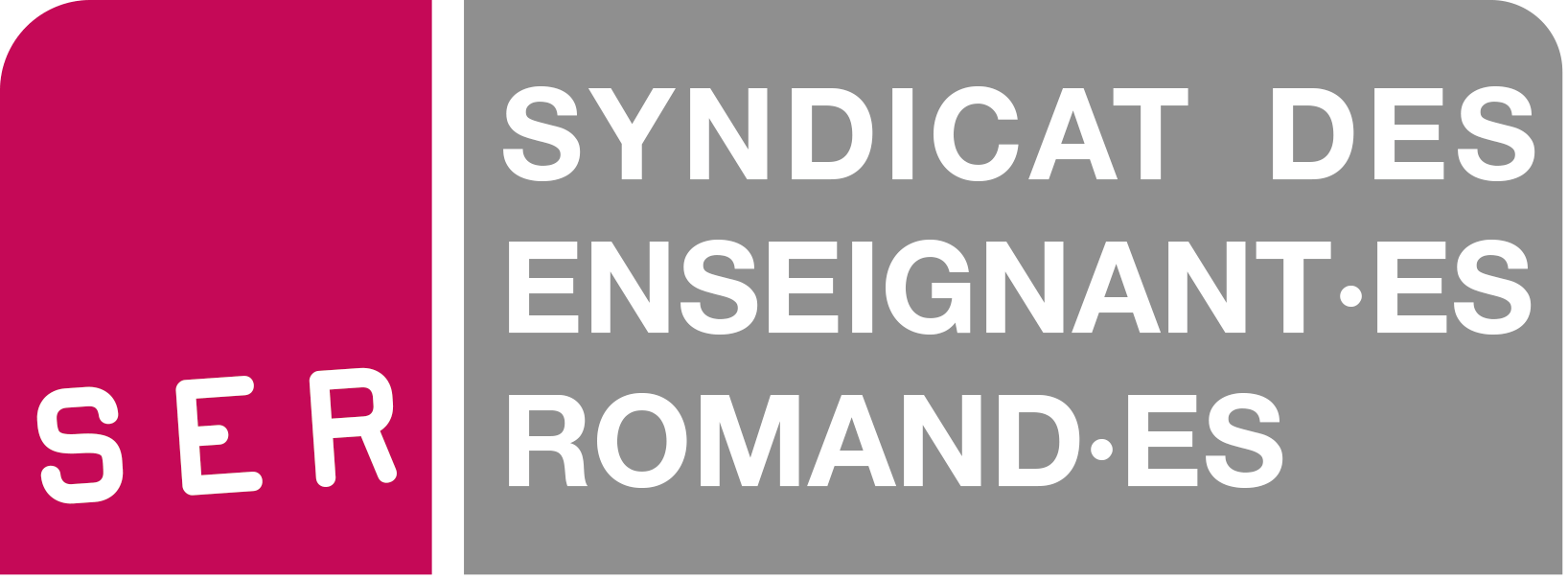Le travail confisqué : anatomie d’une dépossession
Ce que révèle cette longue analyse est clair : le cœur de la crise éducative n’est pas d’abord pédagogique, mais politique. Non pas que la pédagogie soit secondaire — elle constitue au contraire l’espace vital du métier — mais parce que les conditions mêmes qui permettent l’existence d’une pédagogie émancipatrice ont été méthodiquement détruites. Comme le rappellent Bernard Friot et Bernard Vasseur, le premier lieu de la domination capitaliste est le travail, et c’est symétriquement là que s’ouvre la possibilité d’émancipation : dans la maitrise ou non de notre activité, dans la souveraineté ou non sur ses finalités, dans la capacité ou non à imposer collectivement le sens de ce que nous faisons.
Nicolas Framont l’a montré : le salariat n’est pas un contrat libre entre égaux, mais un rapport de subordination. La rhétorique managériale — ses « collaborateur·trices » et ses « partenaires » — fonctionne comme une euphémisation destinée à masquer la structure réelle de ce rapport : la dépossession. Dans l’école, cette dépossession prend la forme d’une hiérarchie déresponsabilisée, d’une verticalisation des décisions, d’outils numériques intrusifs, de collectifs fragmentés et d’une bureaucratisation croissante qui réduit les marges d’intelligence partagée.
Rien n’y relève du hasard. L’objectif n’est pas d’améliorer l’école, mais de produire des professionnel·les isolé·es, assigné·es à la gestion d’impossibilités structurelles et rendu·es comptables d’échecs qu’ils·elles ne maitrisent pas. Selon Danièle Linhart, la souffrance au travail n’est pas une conséquence involontaire du management, mais l’un de ses opérateurs. Elle permet de transformer des contradictions structurelles en fautes individuelles, l’épuisement en manque de volonté, la surcharge en défaillance morale. Ce mécanisme de culpabilisation permet à l’institution d’effacer ses responsabilités en les transférant sur celles et ceux qui en subissent les conséquences.
Dans ce contexte, remettre le travail au centre, non comme marchandise, mais comme espace politique, constitue un acte de résistance. Bell hooks évoquait la pédagogie comme « pratique de liberté » : mais celle-ci n’est possible que si les enseignant·es disposent du temps, de l’autonomie et du collectif nécessaires pour en porter les exigences. Défendre nos conditions de travail n’a donc rien de corporatiste : c’est défendre les conditions de possibilité d’une éducation démocratique, affranchie de la logique productiviste qui la dévore.
La guérilla pédagogique : reconquérir la puissance d’agir
Dans cette séquence politique, la notion de guérilla s’est imposée comme outil conceptuel pour penser la lutte dans un monde saturé de dispositifs, d’indicateurs et de récits paralysants. La guérilla n’a rien de clandestin : elle désigne la manière dont des acteurs dominés trouvent, dans les interstices du champ, des marges d’action que le pouvoir ne peut entièrement clôturer. Miguel Benasayag l’a souligné : l’époque contemporaine a perdu l’horizon de la victoire finale. Il ne s’agit plus d’attendre un grand soir hypothétique, mais d’habiter le présent, d’y ouvrir des brèches, d’y multiplier les gestes modestes, mais décisifs par lesquels on fissure les structures de domination.
C’est ce que Laurent Jeanpierre nomme une politique de l’interstice : une manière d’agir qui ne renonce pas au conflit, mais le déplace sur des terrains où la domination peine à opérer pleinement, où les collectifs peuvent se recomposer, où des pratiques alternatives deviennent possibles.
À cet égard, la grève des TTC fut exemplaire. Elle a montré que les enseignant·es ne sont pas condamné·es à subir : iels peuvent refuser, suspendre, organiser, délibérer. L’arrêt des TTC n’a pas seulement interrompu des réunions : il a réinstitué un espace politique, un temps collectif où le travail a été repris comme objet commun. Au fil des semaines, les équipes ont expérimenté ce que serait une école où les enseignant·es définissent ensemble leurs priorités et où le temps se pense à partir des besoins éducatifs.
Eduardo Galeano l’exprimait ainsi : « L’utopie est à l’horizon … À quoi sert-elle ? À avancer. »
La guérilla pédagogique ne promet pas une utopie accomplie ; elle promet le mouvement, c’est-à-dire la fin de l’immobilisation, de la résignation, de la défaite intériorisée.
Refaire monde : l’action collective comme commencement
Rien, dans l’ordre social, n’impose l’austérité aux services publics. Rien n’exige qu’une école soit un lieu de souffrance ou de normalisation managériale. Rien ne condamne les enseignant·es à la subordination hiérarchique ou à la dépossession de leur travail.
Étienne Balibar le rappelait : l’égalité n’est pas un état, mais un processus. Elle n’existe que dans le mouvement qui la construit. De même, la démocratie professionnelle ne se décrète pas : elle se conquiert, se défend, se réinvente. Et toute politique commence, comme le montre Frédéric Lordon en s’appuyant sur Spinoza, par un affect partagé : le passage de la peur à la colère, de la colère à la joie d’agir ensemble.
Ce passage, nous sommes en train de l’accomplir. La sidération recule, la peur se fissure, le collectif réapparait. Les assemblées se reforment ; les établissements s’organisent ; les voix se rassemblent. Ce que la hiérarchie tente de dissoudre, le conflit peut le recomposer.
Le travail retrouve du sens lorsque nous le reprenons ensemble. L’école retrouve de la dignité lorsque nous refusons sa mise en marché. Les élèves retrouvent un horizon lorsque les conditions pour s’occuper d’eux, d’elles, sont réellement défendues.
Ce que nous avons déjà gagné, ce qu’il reste à conquérir
Nous avons gagné une première bataille : la bataille culturelle.
Nos adversaires ne peuvent plus défendre l’inégalité : ils doivent en travestir les mécanismes sous les mots que nous avons imposés — inclusion, égalité, justice. Ils reprennent nos concepts même quand ils tentent de les neutraliser : c’est le signe que nous avons déplacé les frontières du dicible.
Nous avons aussi entamé la bataille institutionnelle : le DIP et la CIIP ne peuvent plus invisibiliser la souffrance professionnelle ni disqualifier nos revendications comme des plaintes corporatistes.
Le conflit a rendu visibles l’ampleur de la crise et la légitimité de notre analyse.
Reste la bataille politique, la plus décisive : reprendre la main sur notre travail, réinstituer la démocratie professionnelle, reconstruire l’école à partir de ses fondations humaines — temps, collectif, autonomie, coopération. Il ne s’agit pas d’attendre la victoire : il s’agit de refuser de céder, d’affirmer notre droit à un travail digne, à une école juste, à une société où l’égalité ne soit pas un slogan, mais une réalité concrète et matérielle. L’inclusion réelle ne naitra en effet ni d’une rhétorique institutionnelle ni d’une norme juridique vidée de sens.
Elle surgira du geste collectif par lequel nous affirmons que l’école publique appartient à celles et ceux qui la font vivre — et que nul pouvoir managérial n’a légitimité pour nous en déposséder.
Notre puissance d’agir n’est pas une promesse lointaine :
elle est déjà là, dans chaque refus partagé, chaque lien retissé, chaque espace de guérilla pédagogique ouvert dans les interstices du système.
L’inclusion réelle commence ici.
Le monde commun commence maintenant.
Et c’est ensemble que nous en ouvrirons la voie. •
Francesca Marchesini, présidente de la SPG